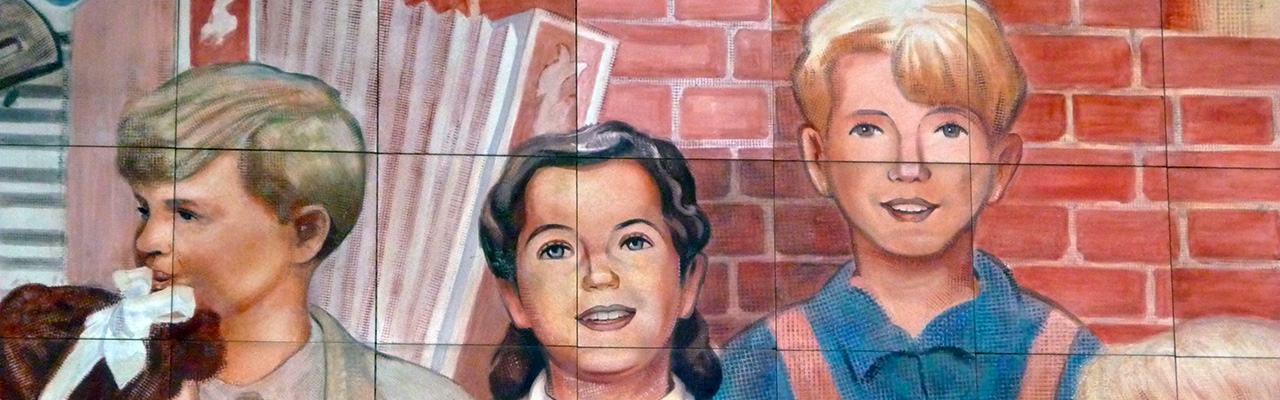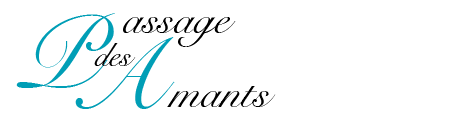I : Ce qui doit être dit
Ça a commencé comme ça. A Vitry-sur Seine, dans un lycée professionnel, en juin 95, un jour d’examen du BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) Commerce. On m'avait demandé de surveiller une salle d'examen particulièrement agitée : jeunes gens assis sur les tables, l'air d'attendre tout autre chose que le sujet de l'épreuve. Pourquoi moi ? j'ai une vague réputation d'autorité, et je suis un homme, au sens d’un être de sexe masculin. J'ai menacé, parlé fort, les candidats se sont assis sur les chaises et tus, à peu près. Tout à coup, bizarrement, une révélation. Ce qui était flou depuis longtemps dans ma tête s'est éclairci: cette remise en ordre, j'y avais pris plaisir. Pour moi. Elle remplissait un besoin. Comme si moi aussi je passais un examen: savoir dominer un groupe. Je pouvais prétendre que je visais un semblant d'ordre pour être tranquille, pour ne pas entendre les propos sexistes, racistes ou simplement bêtes qui surgissent vite dans une salle effervescente, je pouvais aussi me raconter que l'image du prof même médiocrement obéi me sert auprès de l'administration, en un mot que c'était plus facile, je pouvais me raconter tout cela et bien davantage, mais je ne pouvais plus y croire. Cet après-midi, j'étais forcé de constater que ma recherche d'ordre était d'abord à usage interne, personnel, affectif, et plongeait ses racines au plus profond. Faire taire ou distribuer la parole (ce qui revient au même) comptait plus à mes yeux que la qualité de mes cours, l'opinion des profs, des élèves ou du proviseur. En réalité, il n'y avait que cela qui comptait. Parfois je suis fier de mon accent anglais, mais s'il était mauvais je n'en aurais pas honte. Par contre je mets une fierté dans la discipline que j'instaure ou restaure. Là était le défi, l'épreuve que je m'imposais année après année depuis 16 ans, dès qu'une classe a été « la mienne ». Combien de temps me jugerai-je sur ce critère... Test de maturité ? de virilité ? Preuve de mon existence adulte ? Etre soi, est-ce pouvoir s'imposer aux autres, à des jeunes, presque des enfants (était-ce un hasard si je choisissais les classes les plus jeunes, 1ère année de CAP ou 4e Techno... (1) ) ?
Et surtout, pourquoi ? Je déteste les rapports de force dans la vie quotidienne, préfère écouter plutôt que parler, fuis les gros causeurs, les péremptoires m'agacent, je vais vers des relations plus ou moins égales, pourtant je me complais dans un conflit pour lequel je suis très mal armé, n'ayant ni l'ego surpuissant d'un L***** ni le rayonnement de M*****-P*****. Il me manque ce mélange d’enthousiasme et de condescendance dont une romancière a écrit qu’il caractérise l’enseignant toujours à l’aise devant des adolescents. (2) Alors, qu'est-ce qui se joue pour moi, là ?
Un an avant, j'avais composé un manuscrit, à la fois témoignage et essai sur l'école. Quoiqu'intéressées par le sujet et en accord avec mes opinions, des amies très proches dirent leur déception: critique peu ou pas mordante, incapacité à transmettre l'émotion, y compris dans les passages que je jugeais les mieux « ressentis », en particulier celui sur le suicide d'une élève. A vrai dire, en rédigeant le manuscrit, j'avais eu des hésitations, un embarras à mettre les idées en forme, comme si je me heurtais à une difficulté de fond, ni théorique ni de style, mais tenant à ma situation de prof, à ma façon de la vivre: mon expérience passait mal parce que je n'abordais pas ce qui, dans l'école et malgré moi, me convenait. La satisfaction éprouvée par exemple en « matant » des candidats rétifs étant absente de mon texte, chaque page pouvait y être juste, l'ensemble n'en était pas moins faux. Un tel point aveugle suffisait à rendre le manuscrit caduc, fallacieux sur le plan personnel, et faussé sur le plan théorique.
Je n'aime pas l'école, la fuis autant que possible et bien plus que d'autres profs, mais elle remplit pour moi une fonction et comble un besoin. Souffrir de devoir m'imposer, souffrir plus encore des inévitables ratés de cette domination, et en tirer un certain plaisir que je ne cesse de déplorer, réunit ce qu'on peut appeler sadisme (contraindre à obéir) et masochisme (souffrir d'infliger cette contrainte).
Pourquoi entrer et rester dans une institution dont je pense tant de mal et où je suis mal ? Sans doute n'y suis-je pas si mal ! Ce n'est pas par commodité qu'aujourd'hui encore (août 1994) je suis prof de Lycée Professionnel, parce qu'y enseigner serait moins pénible que m'asseoir derrière un guichet de la BNP, mais parce que ce travail en partie me convient. Partir (si je pars) suppose de m'en rendre compte.
Voilà où j’en étais il y a un an.
En moins de douze mois, la mort de ma mère puis de mon père obligea et aida à faire le point.
D'abord, devenir prof prouvait l'emprise familiale sur moi. Non pas qu'on m'aurait poussé spécialement vers ce métier. Mais, plus tristement, en raison du message essentiel transmis par mes parents et hélas trop longtemps reçu par leur fils: en bref, la vie ne vaut guère la peine d'être vécue. Comment s'étonner que je me sois dirigé dans une voie que je n'aimais pas.
Ensuite, la dimension du jeu opposant et unissant prof dominateur et classe dominée (ou l'inverse) m'apparut soudain plus claire. Grande recycleuse d'affection, l’école ! maternante, paternante, copinante... : rien d'étonnant à ce qu'elle se nourrisse aussi d'algolagnie (volupté de la douleur), selon le mot cher à Maurice Heine et Gilbert Lely (3), et je n'étais pas le premier à lui apporter des penchants S-M (au sens de tendance à détruire et à me détruire, mais doucement, à petites doses), qu'elle a bien sûr renforcés, à mon corps consentant.
A l'époque où je rédigeais mon manuscrit anti-scolaire raté, lisant Je suis comme une truie qui doute, j'avais l'intuition de ma contradiction: analyser un sujet sans l'avoir réglé pour moi-même. Claude Duneton, lui, avait composé un livre fort et vrai parce qu'il y avait mis sa personne. (4)
Ou j'intègre la critique de ma vie de prof à la critique de l'école. Ou alors je renonce à l'essai comme au témoignage ou au pamphlet, et choisis la fiction. Ou bien, rien. Voilà ce que j'ai entr'aperçu un jour de juin 93 en salle B 310 au lycée Les Carrières, à Vitry/sur/Seine.
Si vous voulez mentir, écrivez vos mémoires, mais si vous préférez la vérité, faites un roman...
(rédigé en août-septembre 1994)
* * *
II : Départ
(écrit en 1995, après la rédaction du roman-essai-témoignage Banlieue molle, publié en 1998 par HB Editions)
Bien sûr, l'école ne s'est pas effondrée un soir comme dans mon récit Banlieue molle. Ni l'institution, ni le LP qui m'a sucé 17 ans de vie et tient toujours la pente à fleur de carrière, trop bien accroché au fort d'Ivry (5). C'est moi qui ai glissé de la banlieue parisienne à la Picardie. Là m'attendait un autre lycée, blanche meringue au bout de la zone d'activités (on ne dit plus « zone industrielle », ça sonne ringard, sixties, ouvriers à mobylette Peugeot et slogans CGT peinturés et délavés devant une cheminée de brique). L'Oise a remplacé la Seine, et il suffit de sortir de sa salle pour apercevoir une péniche remontant le fleuve, et sur l'autre rive les wagons orange d'un train belge filant vers Bruxelles.
S'attarder à comparer les deux lycées serait encore œuvrer en sociologue, ethnologue, pédagogue... Compiègne ne ressemble pas à Vitry-sur-Seine, mais j'y retrouve le même mensonge, et mes mêmes velléités de fuite.
Aujourd'hui j'ai su que je partirai. Dans un an, dans deux, dans six mois... mais je partirai. Rien de terrible n'est pourtant arrivé. J'ai même à peu près réussi un cours ce matin (disons qu'il a été « suivi ») et même obtenu le calme et un relatif travail (lisez: j'ai bien occupé les élèves) en dernière heure avec une classe souvent agitée. Alors pourquoi, non le désir (présent et trop présent depuis longtemps), mais la certitude d'une rupture à venir ? Eh bien, pour la même raison qui a rendu la journée supportable: l'absence de conflit, d'enjeu, de sens.
Et une image que je n'oublierai pas. Un groupe d'élèves de Bac Pro (que je n'ai pas en cours) assis à l'entrée d'un bâtiment, attendant le prof. Garçons en majorité, grands pour la plupart, en jean presque tous, tassés, massifs. Lourde masculinité adolescente. C'est difficile d'être homme, encore plus de le devenir. Comment mes collègues peuvent-ils ne pas voir que ces jeunes sont mal ? Jeunesse sous pression non à cause du chômage ou de « la crise », mais bien plus profondément parce qu'elle est forcée à la transition vers l'âge adulte, vers l'irréversible, et dans quelles conditions!
Le garçon s'enfonce en lui. Dans les clips, jean et blouson sont synonymes de liberté : ici, ils recouvrent et coincent des jambes d’homme engoncées sous le denim. A les voir, on se rappelle que la raide toile de jean était aux Etats-Unis instrument du travail manuel, et vêture quotidienne des pauvres. Quant aux joggings flottants et baskets aérodynamiques, ils nient tout autant le corps, un corps désincarné car désexualisé, hygiénique, invisible et mieux caché finalement sous le signe du sport que derrière la rêche toile bleue du prolo de Chicago ou des champs de coton.
La contrainte sociale et scolaire, c'est sur la chair et ses mouvements qu'elle s'exerce, Foucault et d'autres l'ont dit mieux que moi. Mais Foucault ne s'est pas assis dans une salle de classe du LCDG (devinez le nom du personnage) entre deux élèves. Moi, assez souvent. Je vous invite. Vous sentez vos coudes forcés de plier contre votre tronc, votre cahier et votre livre risquent l'incident de frontière avec le voisin, votre veste ou blouson traîne par terre, et tant pis pour vos jambes si vous dépassez 1 m 65. Comme pour renforcer l'enfermement, certains gardent sur eux tout le cours, toute l'année, manteau ou blouson de cuir.
A moins que cette jeunesse n'aille en cours professionnel. Elle enfile alors pantalon noir et chemise blanche impeccable de serveur, ou tablier bleu et toque de cuisinier, vêtus de discipline devant le prof appelé « chef ».
Le malcorps, là, ça se soigne. Le garçon gauche qui avait tant de mal à se situer, à se trouver, à poser ses fesses, son dos, ses bras, à atteindre les autres, le voilà rassuré, socialisé, uniformisé, doté d'un esprit de corps. Avec un peu de chance, si la domestication physique est réussie, les tensions n'exploseront pas, ou presque jamais, sinon en de rares éclats comme ce viol d'un élève hôtelier par un autre, dans l'établissement, il y a quelques années.
Un médecin à qui je décrivais récemment ces mornes normalisations m'invitait à moins de pessimisme:
- Après tout, ainsi ils auront un métier. Apprendre des règles, ça leur servira dans la vie.
Le pire est qu'il avait raison. Corsage blanc d'hôtesse ou de serveuse, dents blanches de commande, « Oui, chef », mieux vaut inculquer quelques habitudes de travail - et c'est ce que donne le LP de 1995 comme le Collège d’Enseignement Technique de 1960 - tant que le monde reste ce qu'il est...
Une journée de plus. Pas l'enfer. Ou alors, bien peu infernal... Personne n'en parle, sinon pour le mettre au compte de la fatigue, des rythmes scolaires, d'autre chose que la société et son école. Horreur molle. Petite musique de Jaux (6). Les yeux baissés tristes de Marie-Sophie.
Un lycée immaculé aux couloirs chaque jour entretenus par une armée de nettoyeuses vêtues de vert, qui fournit en main d'œuvre les restaurants et hôtels picards, un lycée que fréquentent peu de Djamila et de Marzouk, où les mots drogue et racket ont un parfum d'exotisme, semble à des années-lumière des « banlieues ». Lycée professionnel, mais d'élite. L'école qui décolle, la confirmation des pédagogues de la réussite, une scolarisation ouvrant enfin la porte à l'emploi ! Vitry nageait dans l'absurde, Compiègne touche le réel.
Vraiment ?...
Ici aussi, français, anglais, histoire-géo, maths, économie, droit, dessin, gym, etc. agrémentent un enseignement professionnel qui se résume à apprendre sur le tas. Dans ce lycée professionnel comme dans presque tous les autres, selon un responsable des IUFM (7), le prof a devant lui des élèves qui « ne peuvent ni ne veulent apprendre ». Et qui souvent s’en accommodent. Deux ou trois ans plus tôt, il avait fallu téléphoner aux élèves de Bac Pro hôtellerie pour qu’ils viennent passer l’examen : certains d’être embauchés grâce à leurs stages, ils estimaient inutile de se déranger pour décrocher le diplôme. A la sortie, même s’ils ont la chance de trouver un travail correspondant à leur formation, l'école n'en aura pas moins été pour la plupart un apprentissage assaisonné de cours-alibi.
17 heures 40. Croyant gagner du temps, les autres profs, presque tous, rentrent chez eux au volant d'une voiture. Je longe l'Oise à pied, sur un chemin qui suit le fleuve jusqu'au cœur de la ville impériale. Lourd d'élèves, un bus me dépasse. Des nez s'écrasent à la vitre pour un regard ou un salut à l'étrange prof qui marche. A Compiègne comme à Paris ou Bamako, être original, c'est facile: il suffit de pouvoir se payer une voiture, et de n'en rien faire. Une passerelle franchit l'Oise et mène aux écluses de Venette. Dans une heure, derrière la colline de Carrefour et MacDo, le soleil se couchera sur une bonne nouvelle: la calme certitude de mon départ (quand ?...). Ce soir est un autre jour.
(mars 1995)
* * *
Notes (2018)
(1) Officiellement, les classes de 3e et 4e Technologiques (beaucoup plus nombreuses en collège qu’en lycée professionnel) avaient pour but de remettre à niveau des élèves en difficulté, notamment en les préparant au brevet des collèges. Réellement, c’était une des voies de garage pour celles et ceux en échec scolaire.
(2) Donna Tart, dans Le Maître des Illusions (The Secret History, 1992).
(3) Maurice Heine (1884-1940) et Gilbert Lely (1904-1985) sont en France parmi les découvreurs de l’œuvre et de la vie de Sade. Maurice Heine est aussi un des premiers membres du PCF : au congrès fondateur de Tours en 1920, il présente une motion de gauche. Le PC l’exclut en 1923.
(4) Parmi les nombreux livres à recommander de Claude Duneton (1936-2012) : Parler croquant (1973), Je suis comme une truie qui doute (1976), un Anti-manuel de français (avec Jean-Pierre Pagliano, 1978), À hurler le soir au fond des collèges : l'enseignement de la langue française (avec Frédéric Pagès, 1984), et La Mort du français (1999).
(5) Après mon départ en 1994, ce LP a même reçu un prénom et un nom, un nom célèbre, celui de la sculptrice amante de Rodin, qui aura vécu ses trente dernières années internée en hôpital psychiatrique.
(6) Jaux, commune de l’Oise, à quelques centaines de mètres du lycée, sur l’autre rive du fleuve, et qu’une passerelle relie au lycée.
(7) Les IUFM, Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, organismes créés en 1990 pour former les enseignants du secondaire public, ont été remplacés en 2013 par les Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education. Moins l’enseignement a de sens et plus les enseignants ont de mal à enseigner, mieux on les forme.
Gilles Dauvé, 1994 & 1995