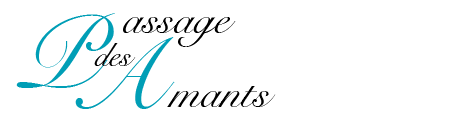Quel avenir pour une histoire d’amour qui commence dans l’indifférence totale ? La première fois que je l'ai vue, je n'ai même pas fait attention à elle. Rien pour soulever mon intérêt, le calme plat, l'électrocardiogramme aussi imperturbable qu'un métronome.
De ce froid matin d'hiver, je peux à peine évoquer la conscience d'une vague blondeur et l'amorce d'un sourire. Peut-être nos bras se sont-ils frôlés ? Peut-être même lui ai-je marché par mégarde sur les talons en lui emboîtant le pas à travers le labyrinthe aseptisé du complexe sportif où j'avais décidé, mue par l'instinct du hamster sur sa roue, de venir plusieurs fois par semaine, histoire de transformer mon agressivité en muscles ? Peut-être mon regard a-t-il erré sur son corps, indifférent devant des courbes que les informes sweat-shirts maison rendaient encore plus troublantes ? Indifférente au rebondi de ses fesses, à sa peau qui faisait penser au sable des plages au petit matin, au triangle de sa nuque qui s’enfonçait délicatement dans les ténèbres de son col. Peut-être même lui ai-je souri ? D'un sourire gentil et distant qui exclut du monde aussi efficacement qu'une flopée d'injures. Je me souviens l'avoir écoutée me vanter les mérites de telles et telles machines et du goût de métal qui inondait ma bouche face à ce gros tas d'écrous et de boulons. Je l'écoutais d'une oreille et la regardais sans la voir, toute préoccupée que j'étais par la douleur causée par les sacs chargés de courses qui cisaillaient mes doigts déjà gourds de froid.
En lui jetant par-dessus l'épaule un au revoir distrait, je ne réalisais pas un seul instant que je venais de rencontrer un de ces amours qui consument et qui brûlent, fort et longtemps, même éteints.
Lundi. Et encore un jour de novembre. Il y a des mois qui, bizarrement, semblent compter plus de jours que les autres. Paris n'est pas tout à fait gris ni certainement plus vert. Une ombre de l'hiver qui se cherche encore rampe comme un brouillard. Les oiseaux ne chantent plus, envolés vers le ciel de mois décents. Je souffle dans l'air glacé un ruban de buée mais je me mets à tousser et rentre la tête dans les épaules. Mon métier m'oblige à avoir des horaires anarchiques qui donnent la fausse impression de ne pas subir de routine. L'avantage de la routine, c'est que ça peut donner conscience du temps qui passe et même fait croire qu'il passe lentement. Si en plus on s'ennuie, le temps ne passe plus, il semble même arrêté.
J'ai pensé à elle toute la journée. Je me rends à la salle de sport en fin d'après-midi, le pas lourd, aucune envie de courir sur un tapis roulant avec la persévérance hypnotique du rongeur malade d'inaction et du manque d'espace. L'urbanité gigogne. Cage après cage. Elle n'est pas là. Je parviens à décrocher un sourire neurasthénique à sa collègue et me traîne jusqu'au vestiaire, le sac de sport pendouillant au bout du bras. Je me venge sur les machines à muscles, je me fais suer, je deviens toute rouge, je cherche à m'épuiser, à éreinter mon corps pour que les angles de mon esprit s’anéantissent, s’écroulent sous l’effort. Méditation physique. Dans le hammam, j'asphyxie mes sens et au milieu des vapeurs brûlantes, j'entrevois une lueur d'apaisement. Je rentre chez moi, ramollie, cotonneuse et shootée aux endorphines naturelles. Avant, je n’ai jamais aimé qui que ce soit avec passion. J'étais passée à travers les balles. Je me suis toujours méfiée de ses élans et des excès nourris d'illusions, confortée par le souvenir d'une professeure de français, grasse comme l'odalisque à l'estrade, qui répétait sans cesse, avec un long et profond soupir proche de la pâmoison, « La passion est dangereuse mes enfants, l’amour écorche comme une épine » tout en caressant de ses doigts boudinés et élégants les pages racornies d'une vieille édition de "Roméo et Juliette".
Je m'assieds à la fenêtre d'où j'ai une vue sur les toits de Paris, une mer couleur d'ardoises, avec pour horizon, les arbres du Père-Lachaise qui couvent leur portée de stèles et de caveaux. J'allume une cigarette piochée dans l'armoire d'urgence. Je fume rarement et quand je fume, j'ai l‘angoisse aux lèvres. Je panse la plaie en inhalant la fumée âcre et sèche qui me brûle les poumons, déclenche une prise de conscience fulgurante et éphémère et je m'apitoie un instant sur mon sort. J'éteins la cigarette sous un jet d'eau froide et dans l'eau chargée de cendres qui tourbillonne dans le siphon, je vois un peu de mon humeur grisâtre disparaître. Son prénom sur un badge en forme de smiley. Quand j’en détache avec délice les syllabes comme une adolescente pré-pubère, les mots de Nabokov viennent s'enrouler autour de mon plaisir. Difficile de vivre un amour vierge.
Orgueil de la Maison vient perdre toute majesté en s'étalant sur le tapis du salon. Des odeurs chaudes et épicées me parviennent des fenêtres ouvertes des voisins, d'origine vietnamienne, et ces parfums me remplissent d'une nostalgie étrange pour des lieux que je ne connais pas. Le dernier morceau du cd s'achève et dans la nuit qui tombe, j'écoute le silence de Mozart.
J'ai franchi le cap de la vingtaine en mettant les pieds dans le plat. Littéralement. J‘ai refourgué à des amies toutes mes chaussures à talons. En perdant de la hauteur, j'ai gagné en visibilité. Combien de femmes portent réellement des chaussures à talons pour leur seul et unique plaisir ? Je me sens rarement aussi peu féminine que du haut de dix centimètres en caoutchouc. J'ai été embauché comme serveuse dans un Hippopotamus, une espèce de restaurant genre Flunch trois étoiles, quand j'avais dix- neuf ans. Tailleur jupe de rigueur, passe encore. Collant chair et chaussures à talons, l'idéal pour cavaler toute la journée entre la cuisine et les tables, soit. Rouge à lèvres orange assorti au vernis à ongles obligatoire et comme je n'avais pas eu la féminité de me faire percer les oreilles, on me prêta généreusement une paire de gros anneaux clips dorés genre vache qui rit. Dans le miroir, un mélange entre madame Irma et Yvette Horner. J'ai rendu mon tailleur le soir même. A presque trente ans, les gens aiment bien que vous soyez mariés et que vous ayez des enfants. C'est dans l'ordre des choses et rassurant pour tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, il faut au moins avoir la décence de s'en plaindre, d'éplucher fébrilement les petites annonces, de chatter sur meetic jusqu'au bout de la nuit avec des fantômes virtuels en s'endormant sur un oreiller de fantasmes, d'organiser des soirées entre célibataires pour faire semblant de prendre tout ça à la légère en soignant son alcoolisme débutant autour de quelques bouteilles de vin rouge bio.
Mardi. Novembre persiste. Je pars travailler le cœur en berne. Toutes ces heures qui me séparent de la prochaine fois où je pourrais croiser son regard. Dostoïevski disait, "il y a des fous partout, même dans les asiles." C'est vrai, il y a des fous même dans les asiles. Le parc de l'hôpital est beau et fleuri. Je respire à fond en passant près des pins et leur odeur de fruit salé m'amène un instant entre les dunes d'une plage des Landes, je me perds dans la contemplation des feuilles de bambou, soulevées par le vent comme une chevelure folle, je froisse un brin de lavande et recueille au creux de ma paume des parfums de garrigue, écrasée sous le soleil. Je tourne la clef dans la serrure, ouvre la porte de mon service verrouillé et la referme dans un cliquetis involontairement bruyant, le bruit de la liberté.
Quand je rouvre la porte, j'ai les nerfs à vifs d'avoir répété des dizaines de fois la même réponse à une patiente obsessionnelle sans parvenir à trouver une issue à notre dialogue absurde. La perspective de prendre un bain de foule sponsorisé par la RATP me donne envie de défaillir en posant une main lasse sur le front, de shooter dans une poubelle ou de me rouler par terre. Un penchant tout neuf pour le théâtre. Paris a su révéler l'hystérique en moi.
De plus en plus de mal à descendre sous terre. Une aversion proche de la phobie qui a gagné en force au fil des années. Je suis persuadée que si je dois un jour être victime d'une bouffée délirante, c'est en train de baver et de ramper le long des rails de métro qu'on me retrouvera pour m'hospitaliser de force. J'ai l'impression d'une plongée dans un inconscient collectif, noir et sordide. Les pires violences semblent soudain possibles sous terre. Cette lumière dégueulasse et crépusculaire, ce béton, cette misère de plus en plus aiguë, ces gens dont on ne voit que les cheveux qui dépassent sous le duvet, toutes ces affiches, ces écrans publicitaires qui vous hurlent au visage et qu'on ne peut éviter qu'en baissant les yeux, comme le vaincu devant l'ennemi, ces effluves complexes où la chaude odeur de croissant et d'urine vient se mêler pour susciter l'appétit tout en le révulsant. Toute cette humanité réunie, cette proximité des corps qui rend le besoin de distance farouche et agressif. Je me souviens aussi de soirs de grande fatigue, de profonde lassitude où, empêtrée parmi les corps raidis et tendus par l'heure de pointe, je m'abandonnais au ressac de la marée humaine. Ma joue frôlait des fourrures aux parfums épicés, mes genoux s'oubliaient dans des creux et des aspérités, mes mains rencontraient des doigts qui se retiraient comme des insectes. Je me laissais envahir par un profond sentiment d'appartenance, un plancton serré parmi ses congénères dans un vaste océan. Et puis les portes s'ouvraient, nous vomissaient d'un jet et je n'avais plus qu'une hâte, remonter dans l'échelle de l'évolution des espèces jusqu'au monde en apparence civilisé qui s'agitait à la surface.
Elle est là. Je croise son regard sitôt franchi le seuil. S'il pouvait y avoir des bulles au-dessus de nos têtes comme dans les BD, dans la mienne il n'y aurait rien, un blanc ou à la limite trois petits points... Elle se tient debout derrière un bureau et réceptionne les cartes de membres avant de tendre une serviette éponge qui sent le vinaigre et le Pec citron, version géante des rouleaux de serviette chaude en fin de repas dans les restaurants chinois. Ses grands yeux bruns contrastent avec la blondeur de ses cheveux. Son sourire a une douceur halogène, une lueur tamisée qui se transforme en un éclat éblouissant au fur et à mesure qu'il s'élargit et illumine tout son visage.
Après six mois de silence et de borborygmes, il serait largement temps de trouver plus original à dire que "bonjour" et "merci" même si je ne remets pas en cause l'extraordinaire puissance évocatrice sexuelle de ces deux mots. J'ai bien été tenté par un "Tiens, tu t'es coupé les cheveux ? C'est joli", c'était plus que joli d'ailleurs, mais j'ai été stupidement confrontée à un dilemme lexical. Je ne peux pas m'empêcher de la vouvoyer une fois sur deux avec une courtoisie empesée, digne du 19ème siècle, qui n'est pas de mise dans une salle de sport parce que tout le monde est pote dans une salle de sport, on se tutoie, on se donne des claques dans le dos, suer ensemble ça rapproche.
Elle s'approche pour me tendre un rouleau de serviette avec un sourire. Rien que de très anodin, alors pourquoi ma vision se rétrécit-elle ? Pourquoi ne vois-je plus que sa main baguée au pouce qui se détache sur le blanc immaculé ? Pourquoi le son qui sort de ma bouche ressemble au premier mot d'un nouveau-né ? Pourquoi ne vois-je la plante verte qui dépérit devant l'entrée qu'au moment où je pose un pied dessus ?
Au fond, il y a quelque chose de délectable à perdre tous ses moyens, quelque chose proche de l'abandon et du don de soi.
Brûlure de son regard le long de mon dos. Frisson.
Je cours à perdre haleine en faisant du surplace sur un tapis en caoutchouc qui fait un bruit de pneu crevé. Autour de moi des visages douloureux et crispés par l'effort. Des souffles rauques et des cris étouffés. Je fermerais les yeux que je pourrais m'imaginer dans un club échangiste. L'orgasme collectif. La masturbation musculaire devant les posters d'hommes et de femmes aux abdos monstrueux et protubérants. Just do it. Une odeur de corps moites, de muscles en surchauffe, de moteur en combustion, une odeur de paroxysme. Des écrans plasmas sont fixés au mur. Occuper l'esprit pendant que le corps s'occupe. Tous ces écrans partout, dans les cafés, le métro, au bout de nos doigts. Même en refusant la prise d'otage, l'objet est là, Il bouge dans un coin du champ de vision et bourdonne comme un insecte. Le journal télévisé. Des images de femmes et d'enfants africains ravagés par la famine. L'écran du tapis roulant m'indique le décompte des calories perdues. Une sensation de vertige m'oblige à retrouver le sol. J'ai soudain très froid malgré la chaleur qui se diffuse dans mes muscles. Je cours en titubant jusqu'au vestiaire. Sur l'écran, la météo s’extasie de pouvoir nager à Dunkerque en plein Novembre. Après la météo des plages, bientôt la météo des pôles, pour suivre la montée des eaux jour après jour.
Par chance, c'est encore le calme avant la tempête bruyante qui va s’engouffrer dans les vestiaires après la fin des cours collectifs.
Les rangées de casiers ressemblent aux alvéoles d'une ruche de larves, gavées aux barres hyper protéinées. Je m'assois sur un banc, la tête entre les mains et, pour faire passer la nausée, me concentre sur le sol qui par endroit se gondole. Un néon vibre et clignote. J'entends la porte grincer. Je glisse une main sous le menton les yeux au sol, cale l'autre contre ma hanche et essaie d'avoir l'air pensif.
- "Ça va ? » Ça irait mieux si je n'avais pas reconnu sa voix qui me fait frissonner. Je garde fermement ma position, main gauche sous le menton, main droite sur la hanche et je remonte lentement le long de ses jambes pour situer mon regard quelque part entre la base de sa lèvre inférieure et son cou.
- "Oui, oui, très bien, je fais une petite pause". Je dois ressembler à Jane Birkin à parler comme ça dans le vide, les yeux fous. Je la regarde, elle me regarde et me sourit gentiment. Une flaque de sourire béat inonde instantanément mon visage sans que je puisse rien y faire.
- "Tu n'aurais pas vu une montre par hasard ? Une adhérente a oublié la sienne hier." Elle se met à fouiller les casiers vides. Je reste assise à la regarder faire pendant quelques instants avant de me ressaisir et de chercher à mon tour.
- "C'est gentil", dit-elle. Elle butine, rapide et efficace. Elle a vite fait le tour de la ruche avant de se planter devant moi avec un air contrit. Je ne peux endiguer une vague déferlante de pensées parasites, « Rentre le ventre ! J'ai utilisé du mascara waterproof ? Je me suis épilée quand pour la dernière fois ? » pas très propices à déboucher sur une conversation décontractée.
- "C'est embêtant, dit-elle avec une moue, elle semblait vraiment y tenir à cette montre". Elle me dévisage avec un regard tout à fait déstabilisant, à la fois flou et scrutateur, le genre de regard qu'on peut avoir face à une peinture abstraite ou à la lecture de René Char.
- "Ah, c'est pas de chance" dis-je, inspirée. Elle ne part pas et reste plantée là. Un étrange silence s'installe, qu’illumine de temps en temps un éclair de néon. Le sol est mou sous mes pieds.
- "Tu viens souvent ici, je te vois presque tous les jours. Tu dois avoir la forme."
Je ne vais pas lui dire que l'énergie que je déploie, je la lui dois et qu'un simple regard de sa part m'injecte l'adrénaline nécessaire à un semi-marathon. C'est vrai que tout le monde me trouve très en forme ces temps- ci. Je suis dopée. Je ferais exploser tous les tests.
- "J'habite pas loin, c'est pratique, ça me permet de venir souvent et j'en ai besoin, ça me défoule.
- Tu as besoin de te défouler ?
- Jamais eu des envies de meurtre avant de vivre à Paris."
Elle rit. Secoue ses cheveux en arrière. Ils frôlent son cou, reviennent se poser sur ses épaules. La vision d'un épi de blé se promenant sur tout son corps inondé de soleil me traverse.
- "Bon, dit-elle en regardant ses pieds qu'elle entrechoque l'un contre l'autre, il faut que je retourne travailler." Et elle plante son regard brun et intense dans le mien. Net, sans bavure, tranchant, clic, le piège qui se referme. Elle fait deux pas à reculons, les mains dans le dos, sans me quitter du regard avant de tourner brusquement les talons. J'entends la porte grincer puis à nouveau le silence. Je prends une douche froide.
Je marche lentement jusque chez moi. L'air vif et froid me donne l'impression qu'on a ouvert les fenêtres de Paris. J'essaye de me concentrer sur ma respiration. L'eau froide n'a fait que fouetter mon sang qui fait maintenant bouillir mon cerveau. Je suis en ébullition. Arrivée chez moi, j’essaye de faire diversion. Je regarde " Question pour un champion" jusqu'au bout, en tentant de répondre à chaque question, je m'intéresse à la vie associative et à la passion pour la cruciverbie des candidats, je spécule sur la couleur et les motifs exacts de la cravate du présentateur, je lis les ingrédients au dos du plat préparé que je jette dans le micro-onde et quand je m'apprête à découvrir la composition exacte du détergeant de la salle de bain, je fonds en larme. Des larmes sans le lest de la douleur. Des larmes qui balancent par-dessus bord un fouillis inextricable de sentiments impétueux et épuisants. Comment séparer les projections fantasmagoriques des sentiments réels ? Et sont-ils dissociables, ou l'amour se berne-t-il toujours de l'amour de soi qui vient enjoliver l'amour de l'autre ? "J'ai envie de tomber amoureuse", combien de fois avais-je pu dire ça ? Envie d'aimer. Aimer aimer. Combien de gens attendent l'amour, attendent d'aimer. Qu'est-ce qu'on attend pour aimer? Si j'étais vraiment capable d'aimer, j'écrirais à Julien Lepers pour le remercier d'avoir donné tant de moments de plaisir à ma grand-mère malvoyante. Merci Julien. J'adore tes cravates.
Bientôt Noël. Des rues illuminées comme des sapins. Éteignez la lumière en sortant s'il vous plait. Des vitrines ventrues, boursouflées d'objets colorés et inutiles, devant lesquelles dorment des SDF. Il fait froid, ça fait du bien. De ce froid vif qui rafraîchit les pensées, les rend plus aériennes et leur font prendre de la hauteur. C'est beau la vie, ça doit être beau. Parce que.
Et si je lui offrais un cadeau pour Noël, histoire de pouvoir dire quelque chose sans avoir à ouvrir la bouche ? Mais d'une part, je me vois mal me planter devant elle avec mon paquet enrubanné comme un vieil amant dans son imper flapi, comme si nous partagions quoi que ce soit d'autre que des regards troubles. D'autre part, ça veut dire faire les magasins, me noyer dans une foule épaisse, gravir les mâchoires acérées d'escalators en surchauffe et subir cette réaction chimique interne, ce court-circuit neuronal qui me fait errer au milieu d’un magasin, le cerveau vide. Si je n’ai pas de liste en main, je repars avec des trombones, des rouleaux de serviette ou des allumettes à bois.
Je pense à elle en aidant ma mère à farcir la dinde, je pense à elle en riant aux blagues que je ne comprends pas de mon oncle, je pense à elle en levant ma coupe de champagne pour le quatrième toast, je pense à elle en portant un toast malade aux toilettes, je pense à elle en compulsant mon cadeau de noël, un dictionnaire que j’étrenne en regardant à "Obsession". Après le sobre "idée fixe", je me repais de "l'idée, sentiment, image souvent absurdes ou incongrus qui surgissent dans la conscience et l'assiègent, bien que le sujet soit conscient de leur caractère anormal". Je suis anormalement assiégée.
Il neige au matin du 25 décembre. J'ai abrégé les libations en invoquant le risque hypoglycémique d'Orgueil de la Maison. Un besoin de solitude aussi mordant que le froid qui me fait serrer les dents, qui m'enchaîne les mains au corps et brûle mes yeux de larmes dont je ne retiens pas le cours glacé. Pourquoi cherche-t-on avec tant d’avidité à partager son intimité avec quelqu'un ? Pourquoi la solitude nous est-elle aussi intolérable qu’elle nous pousse à dédaigner les jours précieux d'une vie si courte ? Pourquoi ce besoin de croire que la vie ne s'accomplit qu'à deux ? Pourquoi agissons-nous comme des monozygotes qui s'ignorent ?
Je connais bien quelques moyens pour m'oublier, incluant l'alcool, le sexe, le haschich et autres substances capables de tordre la réalité le temps de quelques heures, mais l'une des seules façons qui me permettent d'oublier le poids de l'existence en respectant l'intégrité de mon organisme, c'est de voir un bon film dans une salle obscure où je serais seule au premier rang. Je marche près d'un kilomètre à travers le labyrinthe à la taille démesurée d'un complexe cinématographique qui ressemble à un vaisseau spatial pour échouer dans un fauteuil qui pourrait accueillir deux personnes. Le film est mauvais et m'embarque. J'oublie que je vais mourir.
- " Non, monsieur F. je ne vous donnerais pas un autre pull. Quatre c'est déjà bien assez, vous allez mourir de chaud."
Je ne sais déjà pas comment il peut supporter cet amas de laine sur le dos avec le chauffage malade de l’hôpital poussé à fond. Monsieur F. n'insiste pas, contrairement à son habitude, mais le supplice de la douche matinale l'a considérablement ébranlé. Chaque couche de vêtements retirée semble lui être aussi douloureuse à supporter que si on lui arrache une couche de peau. Entre les psychiatres partisans de la fonction protectrice de la superposition du vêtement chez le psychotique et ceux pour qui il est dans son intérêt de se mettre à nu, au sens propre comme au figuré, il me semble que le bon sens serait de réparer le chauffage central. J'assiste ensuite à l'entretien médical entre une patiente et le docteur Morris, l'un des médecins référents du service. Le psychiatre semble particulièrement absorbé par les coutures de son costume pendant que la patiente se permet de respirer entre deux salves d'une logorrhée mitraillette. J'ai lâché depuis longtemps le fil de son discours. Les limites de compréhension de la folie sont hélas vite atteintes. Très vite, trop vite, le patient est seul à s'enfoncer dans la forêt obscure et on ne peut plus que le regarder partir, debout à la lisière, en tentant vainement de l'appeler. Je regarde par la fenêtre un homme s'étirer mollement sur le balcon de l'immeuble voisin, tousser dans l'air frais avant d'allumer une cigarette qu'il se met à fumer pensivement en contemplant la circulation. Le docteur Morris lève les yeux de sa cravate.
- "Très bien madame D., dit-il d'une voix douce, je crois que nous allons en rester là pour aujourd'hui". La patiente s'arrête net, la bouche encore ouverte, en clignant frénétiquement des yeux. Je peux distinctement voir tous les mots encore coincés dans sa gorge et je me retiens de lui crier "crachez !" Tant son corps semble crispé par l'effort que lui impose le silence. Docteur Morris se déplie lentement et lui serre la main tout en lui montrant la sortie. Elle marche comme une funambule vers la porte que je lui ouvre en essayant de capter son regard mais elle est encore au fond des bois.
- "Bon, je préfère vous faire mes adieux tout de suite au cas où je gagnerais à l'EuroMillions ce soir." Tristan nous dit adieu toutes les semaines. Et revient tous les lundis sans prononcer un mot avant mardi. Je sirote dans la salle de repos du personnel le café tiède et acéré fourni par les cuisines de l'hôpital. Un arrière-goût de bitume en plein soleil, mais efficace.
- "Ce café est vraiment infect", marmonne Jean-Pierre avant de jeter un coup d'œil à l'horloge. Pas une journée sans qu'il ne réitère sa remarque. Et ce à quoi répond invariablement Delphine :
- "Oui, mais il te maintient en vie parmi nous". C'est vrai que Jean-Pierre est un étrange croisement entre un mollusque et un lémurien. De longs membres fins et flasques, un cou télescopique, de grands yeux couleur d'abysses et une voix tremblante et gélatineuse. Regarder travailler Jean-Pierre, c'est comme regarder un poisson derrière la vitre de son aquarium, délassant et vaguement angoissant.
Je fais un rapport oral de l'entretien auquel je viens d'assister. En omettant les détails, il se résume à peu de choses. La patiente traverse toujours les hautes sphères d'un état maniaque qui dure depuis des semaines.
- "On se fait un ciné après le boulot ?" me glisse Delphine en s'emparant de ma tasse vide. Je la rejoins dans la cuisine où elle s'attaque à la vaisselle de tout le personnel, ça la détend. Je la regarde un instant, je regarde ses mains, usées par l'usage abusif des produits ménagers 100% recyclés avec de l'acide citrique, ses avant-bras nerveux, striés de veines fines et saillantes.
- "Je ne peux pas, il faut absolument que je passe à la bibliothèque avant la fermeture. Des bouquins en retard..."
L'excuse est nulle mais comme j'ai du mal avec les mensonges, je ne me foule pas quand il s'agit d'en dire un. Mensonge de merde, mensonge a moitié pardonné. Delphine hausse un sourcille vers moi et ébauche un début de sourire narquois.
- "OK, une prochaine fois. Pousse-toi de là, tu envahis mon espace méditatif", dit-elle en me projetant quelques gouttes parfumées de liquide vaisselle. Je ne sais plus combien d'invitations j'ai refusées sous divers prétextes, juste pour croiser son regard et lui dire bonjour. Mon rendez-vous secret qui me tient en haleine toute la journée.
Elle : " Bonjour."
Moi : "Bonjour."
Vous aurez beau être capable de déblatérer sur les sujets les plus pointus, maîtriser la langue française comme un membre de l'Académie, savamment verbaliser le moindre mouvement de l'âme et nommer la plus subtile des émotions qui vous traverse, il n'y a rien à faire, parler, c'est vite toucher aux limites de la relation humaine. Un bonjour long comme un discours, troublé en surface, ravagé en profondeur. Rien ne pourrait de toute façon décrire l'orage qui m'habite en cet instant. Une sonate de Beethoven sur ses vieux jours, jouée à l'envers. Un fracas de porcelaine jeté sur un tas de paille humide. Indescriptible. Ses regards ne se font-ils pas plus intenses et plus insistants ?
Je ne passe pas par la case tapis roulant et me rends directement à la minuscule piscine de la salle qui donne directement, à travers sa grande baie, sur l’accueil et son dos frêle.
Pendant que j'enchaîne les longueurs de deux brasses, je la regarde évoluer. Je ne sais pas qui est dans l'aquarium, si c'est elle ou moi. Elle court dans tous les sens, vive et alerte, un sourire commercial plaqué sur le visage. Je la regarde éclater de rire, trop fort et trop souvent pour que cela soit authentique. Les hommes fondent, les femmes s'émeuvent.
Le chlore me brûle les yeux, je commence à voir flou et la peau de mon crâne semble vouloir ne faire qu'un avec le latex du bonnet mais je continue à macérer dans l'eau javellisée en guettant chacune de ses apparitions avec le cœur battant. Alors que je sors la tête de l'eau en clignant des yeux enflammés, je l'aperçois qui pénètre dans l'espace aquatique en enfilant une paire de sur-chaussures bleues. Je reprends mon souffle. Je suis seule dans la baignoire. Elle se dirige vers le local où le prof d'aquagym range tout son attirail. Les haut-parleurs se mettent à diffuser de la musique, mélange sirupeux de piano et de flûte de pan. Elle sort en souriant. Avec le chlore, son visage est entouré d'un halo brumeux.
- "Ça te plait ?"
Scotchée à la paroi du bassin et alors qu'une partie de mon cerveau a tout à fait assimilé la question, j'ouvre la bouche pour dire :
- "Comment ?"
Oui, comment. Si seulement je pouvais me noyer dans la piscine là tout de suite, mais d'une part, je sais nager et d'autre part, j'ai pied partout. Le constat de ma débilité fige mes traits consternés. Elle semble perplexe et penche la tête. Le vent de l'inspiration souffle à mes oreilles :
- "Tu as le temps de te baigner de temps en temps ?
- Oui, ça m'arrive tôt le matin, avant que les premiers adhérents n'arrivent." Je l'imagine seule dans un silence aquatique, uniquement perturbé par le clapotis de l'eau, dans les vapeurs qui s'élèvent en volutes à la surface.
- "Ça doit être sympa", dis-je tout bas. Elle s'agenouille soudain tout près de moi et plonge la main dans l'eau, à quelques centimètres de ma poitrine. Ses cheveux blonds caressent furtivement mon épaule pendant qu'une bouffée de son parfum aux fragrances masculines me fait fermer les yeux.
- "Elle est bonne, je te rejoindrais bien."
Elle se relève, quitte l'espace aquatique dans un nuage de chlore. Viens te baigner.
- "J'aime bien le cours de Jean-Michel, je le trouve très punch mais y a pas à dire le cours d'Erwan c'est quand même plus hard, il envoie tout.
- Et puis qu'est-ce qu'il est bien foutu. Ces abdos c'est du galak, je ferais bien une indigestion de chocolat blanc..."
J'en boirais mon gel douche tellement j'en ai marre des conversations de vestiaire. Il fait chaud et humide, un climat équatorial après le passage d'une nuée de femmes en sueur. Je sors de la douche en slalomant entre les flaques qui stagnent le long des gondoles du lino. Ma tête bourdonne plus fort que le néon. A peine habillée, la moiteur s'insinue entre mes vêtements et déjà j'étouffe. Je quitte le vestiaire et aspire l'air climatisé du couloir en m'appuyant contre le mur. Face à moi, dans une machine étincelante qui ressemble à un robot-ménager géant, s'alignent des rangées de produits dopants aux packagings incendiaires. Flammes incandescentes sur fond noir, éclairs jaunes fluo sur dégradés de bleus sombres, par ici la combustion instantanée. A côté, une machine à café marron sanitaire ronfle comme une vieille chose dans un gargouillis de lait écrémé. Un homme, dont la largeur en muscle semble dépasser la taille, glisse une pièce avant de mordre dans une barre hyper protéinée aussi épaisse qu'une semelle orthopédique. Il me regarde mais ne me voit pas, l'œil légèrement vitreux, tout occupé à la mastication consciencieuse de ses futures fibres musculaires. Je sens battre entre les murs le rythme tressautant d'un cours de zumba. Des hommes et des femmes viennent régulièrement s'abreuver à la fontaine artificielle, essuyant de la paume les gouttes qui coulent le long de leur menton. Un homme peste devant la machine à café en recrachant d'un air dégoûté une gorgée de soupe instantanée dans son gobelet. Je continue à tenir les murs. Erwan passe en lissant ses abdos d'une main distraite. C'est vrai qu'on pourrait jouer aux échecs sur son ventre. La clim tourne à fond dans un grand vent de sueurs. Par la fenêtre je vois les branches maigres et encore feuillues d'un peuplier. Si je force un tout petit peu mon imagination, je pourrai distinguer, sous le bruissement des feuilles, un étang brumeux gagné par le gel, hérissé de joncs et de roseaux. Si je continue à pousser, j'aperçois près d'un ponton, les contours d'une petite maison en bois et la lumière chaude que projette une fenêtre sur l'étang et fait briller la glace comme un diamant sucré. Dans la forêt alentours, j'entends, au creux du silence noir et profond...
- "Hé ! Ça va ?"
Une forêt de jambes... Je me râpe les coudes sur la moquette en essayant de me remettre debout. Une main petite et puissante prend mon bras gauche et glisse l'autre le long de ma taille. Elle va finir comme le héros de Süskind si elle continue à porter ce parfum.
- "Ça va, je vais bien, c'est rien", dis-je d'un ton abrupt en me dégageant brusquement. Je me jette à moitié dans les escaliers, juste envie de sortir de cet enfer de néon et de blancheur crue comme une aspirine frétillant dans un verre un lendemain de cuite.
Je suis presque chez moi quand je réalise que j'ai oublié de récupérer ma carte d'adhérente. J'ai tourné la clef dans la porte en me disant que je n’en ai rien à foutre et décide de ne plus retourner dans cette usine de tôles ondulées. Pas envie de vivre dans l'obsession. Pas envie de me nourrir de fantasmes. Pas envie de la maladresse des amours débutantes. Pas envie des espoirs qui font vivre. Pas envie d'être amoureuse et compter sur l'autre pour donner un sens à tout ça. Jouir du corps pour oublier qu'il est déjà mort. Courir après le plaisir des sens pour chercher un sens. Je tourne en rond dans l'appartement, incapable de me concentrer. Je commence à me détendre en arrosant les plantes. Plongée dans de tendres pensées chlorophylles, j'entends un interphone sonner.
- "Oui ?", dis-je d'un ton revêche quand j'ai réalisé que c'est le mien.
- "Mademoiselle Grangier ? C'est Anna, du sports-club. Vous avez oublié votre carte, j'ai relevé votre adresse et comme je passais par-là, je me suis permis de vous la rapporter.
- Merci, c'est gentil mais il ne fallait pas..." Je regarde mon doigt en suspens sur le bouton d'ouverture puis je m'écarte lentement de la porte avant de piquer un sprint à travers l’appartement. J'envoie valser derrière le canapé un paquet entamé de chips au vinaigre, une vieille édition chiffonnée de "Martine à la plage", inexplicable, et un gode en caoutchouc tout mâchonné, jouet préféré du chat. Je sais que je suis écarlate quand je lui ouvre la porte et ma gêne atteint tous les sommets quand elle franchit le seuil d'un pas tranquille, sans que je l'y ai invitée, fraîche, le sourire aux lèvres, déjà maîtresse des lieux. Je suis trop occupée à faire rentrer de l'air de façon normale dans mes poumons pour être polie ou l'envoyer se faire voir. Elle jette un coup d'œil rapide autour d'elle. - " C'est mignon chez toi. » Elle porte une veste noire, courte et cintrée, à gros boutons, fermée jusqu'au col, un jean délavé et des bottines noires qui luisent. Elle tire une carte de se poche.
- « Tiens… » dit-elle en me la tendant, le bras levé, sans bouger d'un centimètre vers moi. Je fais trois pas et frôle le bout de ses doigts en saisissant un coin de la carte plastifiée. Elle ne la lâche pas et nous nous retrouvons dans une position absurde. Je tire légèrement, elle raffermit sa prise. Je la regarde alors. Ses yeux brillent d'un éclat un peu dément, si intense que j'ai l'impression qu'un court-circuit va se produire quelque part, dans la pièce ou dans mon corps. Elle tire lentement la carte à elle en même temps que tout mon corps se rapproche, aimanté comme le reflux des marées vers le large. Je ne peux plus quitter des yeux son regard fou et je ne sais pas si le sourire qui se glisse sur ses lèvres est cruel ou bienveillant. La carte disparaît de nos mains et tombe à terre dans un bruit mat. Elle glisse une phalange au creux de mon poignet, là où affleure le bleu des veines. Elle ne dit rien et continue à occuper le silence de son regard. Je respire à peine, l'impression que l'océan s'évase à partir de ma taille et que sous mes jambes s'ouvrent des fonds abyssaux. Sa main remonte tout doucement le long de mon poignet jusqu'au pli du coude. Je pousse un soupir en tournant lentement la tête de droite à gauche avant de prendre son visage entre mes mains et de saisir violemment ses lèvres. Elle enfonce sa langue dans ma bouche, puissante et musculeuse, un poignard de chair. Je m'enfonce plus profondément dans l'océan et ne peux m'empêcher de gémir. Je tire sa tête en arrière. De la salive brille sur ses lèvres, son regard est espiègle, animal et je n'y lis aucune connivence, juste une soif intarissable, inextinguible. Elle fait sauter le premier bouton de ma chemise et déboutonne tranquillement les autres un par un, la tête penchée sur le côté. Quand elle en rabat les pans de part et d'autre de ma poitrine, j'ai l'impression que c'est tout mon corps qui s'écartèle. Nous glissons du canapé pour tomber entre les plis du tapis. Elle s'agenouille au-dessus de moi, cale son pubis contre le mien et s'aide de mes mains pour faire disparaître sa veste, son pull et son t-shirt. Elle se redresse, à demi-nue et les épaules frissonnantes, un air de défi sur le visage. Du bout des doigts je suis les contours d'une cicatrice, ancienne mais encore légèrement boursouflée qui part du mamelon et sinue le long de son sein gauche. Son mamelon rétrécit et se durcit. Je le prends délicatement entre mes dents et le presse du bout de la langue. Je l'entends soupirer au-dessus de moi et je sens le rideau de ses cheveux caresser mon front sous sa nuque ployée. J'augmente la pression. Elle exerce un léger mouvement du bassin, presque imperceptible mais lent et régulier. Une éclosion au creux du ventre, un désir qui fleurit, vif et puissant, et qui emporte tout dans le désordre des sens.
Il est tard. J'ai encore son odeur sur la peau et son goût sur la langue. Assise dans la cuisine, je m'absorbe dans la contemplation d'un carré de lumière bleue que projette le clair de lune à travers le vasistas ouvert. Le froid de l'hiver s'enroule autour de mes jambes. Une lampe-tempête oscille devant la fenêtre et étire des ombres sur les murs. Ces moments immobiles où l'on cesse d'avoir soif. Immobile et conscient.
Elle est partie sans un mot, son souffle contre mon oreille.
- "Bon, je préfère vous faire mes adieux tout de suite au cas où je gagnerais à I'EuroMillions ce soir." On est déjà vendredi. Le temps passe vite quand on ne le retient plus. Tristan vient me jeter un vague signe de main, l'esprit déjà accaparé par des calculs statistiques tout personnel à base de division de dates anniversaires. Je retourne à ma détresse informatique. Depuis que la direction a décidé d'informatiser tout le système de transmissions infirmières, nous avons fait beaucoup de progrès au poker. Une partie permet rapidement de savoir qui va se coltiner la retranscription informatique du rapport journalier et c’est comme ça que je me retrouve tout le temps devant un ordinateur poussiéreux qui ferait passer l’Amstrad pour du high-tech. Je rentre « des données » sur des gens hospitalisés, coche des cases et remplis des items, en espérant la panne d'électricité monumentale qui va remettre en cause l'informatisation de tout à l'hôpital. Je soupire bruyamment en cherchant la lettre K quand une main vient se poser, légère, sur mon épaule.
- "Ça va toi ? Tu planes complètement aujourd'hui. Morris t'a demandé trois fois le compte-rendu du scanner de Monsieur F. et tu es restée plantée sur ta chaise en lui souriant avec un air de Bouddha. Un qui n'aurait pas boudé son désir...
- Mais il est où le K, c'est pas possible !
- C'est toi le cas," dit Delphine en poussant mes mains pour taper à ma place le mot Kinésithérapie.
- "Si on ne remplace pas le poker par la courte paille dès lundi, je démissionne.
- Adresse ta réclamation au cadre sup, je suis sûre qu'il se penchera très sérieusement sur ton K. C'est qui la fille qui te fait sourire comme ça ? »
On a eu la mauvaise idée de boire trop un soir avec Delphine, mariée, trois enfants, une maison, un golden retriever, une pierrade Tefal, et de pousser le mauvais goût jusqu'à coucher ensemble. On continue seulement à boire trop souvent ensemble. N'empêche qu'une étrange intimité s'est installée depuis entre nous, mélange de possessivité et de détachement, de celle possible entre les membres d'une famille qui se reposent sur l'amour acquis.
- « Rien, de quoi tu parles ? » Je feins l'étonnement avec le naturel d'un acteur de No, les yeux exagérément ronds et la bouche en cul de poule.
- "D'ac-cord, dit Delphine en détachant les syllabes, y a rien, en attendant tu prends le premier Boeing 745 direction la Terre. Docteur Malot t'attend pour l'entretien familial de madame G."
Rien de réjouissant en perspective. Voir cette pauvre femme se débattre contre la volonté implacable de son frère, illustre représentant de la famille naphtaline, qui a décidé de l'exclure de la sphère familiale, sans heurt et sans bruit, en essayant de la faire enfermer pour le reste de ses jours dans une clinique spécialisée. Elle ne peut même plus prétendre au titre de "gentille folle de la famille" depuis qu'elle s'est, selon son frère, attelée à la « redécoration de l'intérieur". Elle a proprement dévasté le premier étage de la maison familiale dans un accès maniaque. Hiroshima à la Baule-les-Pins. Son frère tient un double discours pendant tout l'entretien, ponctué de regards lourds de sous-entendus et de clins d'œil complices dans notre direction pendant qu'il prend un ton badin et des plus dégagés pour évoquer devant sa sœur les "petits désagréments" que provoque sa pathologie dans la vie de tous les jours. Je sors de l'entretien vaguement nauséeuse en me demandant de quoi au juste je suis complice. Ne vaut-il pas mieux au fond pour cette femme être éloignée d'une famille qui ne la traitera jamais qu'en paria ? Alors que je suis à nouveau plongée dans les eaux troubles de l'écran, une patiente que je connais bien entre en trombe dans le bureau et vient se jeter dans le fauteuil à mes côtés en tournant brutalement la tête de droite à gauche. Je la salue d'un mouvement de tête et continue à pianoter. Je la sens se détendre, sans doute influencée par l'intense concentration qui règne dans la pièce.
- "Et tu fais quoi dans la vie, miss ?", me demande la patiente au bout d'un moment avant de décoller sans attendre la réponse.
Trois jours loin de la salle de sport. J'ai largement entamé le paquet de cigarettes de secours, cinq cent soixante-seize cheminées me séparent des premiers arbres du Père-Lachaise et Julien a changé de cravate tous les jours. Est-ce qu'elle pense à moi ?
Je travaille de nuit pour dépanner une collègue. Je déteste ça. Un acte de violence contre un organisme parfaitement adapté au rythme biologique jour-nuit. Je régresse à partir de minuit pour atteindre un stade fœtal vers trois heures du matin. Je me traîne de chambre en chambre, sous les lumières fatiguées des veilleuses, une lampe torche à la main pour scruter les corps endormis dans la pénombre, en croisant parfois des regards rouges et égarés, pris dans le faisceau de la lampe. Je me mets à leur place et ne m'en sens que plus déprimée. Être ainsi balayé par une lumière froide, ne pas pouvoir discerner de visage au- dessus du jet éblouissant, se sentir un animal tapi au fond d’une grotte.
Quelques heures plus tard plus tard, la sonnerie du téléphone me tire d'un sommeil abruti. J'essaye d'ouvrir les yeux pendant que le téléphone continue à sonner. C’est le milieu de l'après-midi et un pâle soleil d'hiver s'immisce entre les volets. Il paraît que les gens qui travaillent de nuit pendant plus de vingt ans diminuent de cinq à dix ans leur espérance de vie. Je connais des moyens plus simples et moins désagréables de raccourcir ses jours. Je me fais couler un café en jetant un coup d'œil aux horaires de séances de cinéma. Je savoure ma deuxième tasse de café quand le téléphone sonne à nouveau.
- "Oui ?
- Bonjour madame Grangier, c'est Anna du sports-club." J'ai immédiatement reconnu sa voix. Son ton est piquant et onctueux. "Je vous appelle pour vous rappeler que votre abonnement expire bientôt et pour vous motiver à venir nous rendre visite le plus souvent possible entre temps pour rentabiliser votre dernier mois." Elle plaisante ou quoi, j'ai dû rentabiliser les trois prochaines années. Je vais bientôt faire craquer mes chemises. " De plus, je vous informe qu'aujourd'hui a lieu une dégustation gratuite du tout nouveau produit énergétique de la gamme Freelax et en tant que...
- Je t'arrête tout de suite merci. Si tu as envie de me voir, il y a des moyens plus... chaleureux, de me le faire savoir.
- Oui ?
- C'est quoi ce baratin professionnel ? Garde-le pour tes protéivores et rappelle-moi si tu as envie qu'on fasse quelque chose ensemble, ciao !"
Je raccroche brutalement. L'hébétude dont je n’arrive pas à sortir et sa voix de haut-parleur SNCF creusent un cratère de magma en fusion. A quoi est-ce qu'elle joue ?
Je tamise la lumière pour obtenir une clarté orange doré, comme une flamme derrière la peau d'une clémentine, je fais brûler des bâtonnets d'encens parfum "feu de cheminée". Cette mode de la déco "nature". On fleurit son appart, on boise son salon, on met de la paille, du raphia, du torchis, des coquillages et des galets dans la salle de bain, on accroche des papillons en plastique, on suspend de faux oiseaux pendant que les vrais disparaissent. Et quand on se retrouve dans la nature, on sort la citronnelle, la paille ça pique, le sable ça gratte, il y a des insectes qui n'existent que pour s'immiscer dans tous les trous qu'ils peuvent bien trouver et la boue n'est pas un soin esthétique. Je mets le Stabat Mater de Vivaldi et m'allonge sur le velours du canapé. Est-ce que je savourais autant le moment si j'étais deux ? Les sens exacerbés par cette solitude toute vouée à l'intensité du moment.
J'ai dû m'assoupir quand le téléphone sonne à nouveau. L'air est saturé du parfum de l'encens froid.
- "Allô ?
- C'est moi."
C'est elle.
- "Tu viens nager ? Elle est bonne.
- Nager hein ?" Ma montre indique qu'il est minuit passé.
- "Oui, j'ai les clefs de la salle. Tu viens ?"
Nager dans la pénombre, brassées par l'eau silencieuse. Son corps humide.
- "Je viens.
- Je t'attends, à tout de suite."
Elle m'attend. Je fourre mes affaires de piscine dans un sac et ouvre grand la fenêtre. Le ciel est terne et sans étoile, quelques nuages roses de science-fiction. Tous ces carrés, ce béton et ces murs qui obstruent le ciel. Construire toujours plus haut pour se familiariser avec cette immensité vertigineuse qui écrase. Je marche à pas vifs en soufflant dans le froid. Je pense à la douceur des naseaux d'un cheval, aux feuilles mortes qui tapissent le trottoir de mes semelles spongieuses, aux forêts de bambous qui poussent aux balcons. Elle m'attend. Tout pour ne pas y penser et rebrousser chemin.
Il n'y a aucune lumière quand j'arrive au club. Je pousse la porte vitrée qui s'ouvre sans résistance sur la pénombre et me guide grâce aux points lumineux qui clignotent çà et là. Je ne reconnais rien et j'ai soudain le vertige, l'impression d'être à la cime de quelque chose et que l'air est devenu solide. Quand je commence à paniquer, une main saisit la mienne. Dans l'espace aquatique, l'air doux et chaud, saturé de chlore, m'enveloppe sitôt franchi le seuil et je sens un long frisson de plaisir détendre mon corps aux aguets. -"J'ai débranché les caméras", me souffle-t-elle. Nous nous déshabillons en silence. Je devine ses courbes caressées d'ombres. Je plonge la tête la première, mon corps se dilue dans l'eau et mon désir se soulève progressivement comme une lame des grands fonds. Elle me rejoint, nous nous ébattons quelques minutes, tous mes sens s'aiguisent dans une obscurité au parfum de violette. Je m'accroche au bord et pose la tête entre mes bras croisés, le corps électrisé par le léger ressac qui vient caresser mon dos. Elle s'approche sans bruit, juste un clapotis moite et un léger mouvement de l'eau qui glisse entre mes jambes. Des images de créatures abyssales, magnifiques et monstrueuses, me traversent l'esprit, quand je sens sa main remonter du bas de mon dos et suivre ma colonne vertébrale jusqu'à la nuque qu'elle saisit d'une main ferme, me fait pivoter et aspire l‘eau qui nous sépare en collant son corps contre le mien. Je n'arrive plus à faire la différence entre la douceur de l'eau et la douceur de sa peau. Sa bouche et ses lèvres ont le goût du chlore. Elle s'insinue en moi comme un courant chaud, remonte le cours de mon désir jusqu'à le faire exploser dans un cri que j'étouffe au milieu des bulles. J'oublie tout.
J'ai beau me pincer le bras sous la table, rien n'y fait, je sens le sommeil enliser mon cerveau avec une force de succion implacable. Les voix passent au-dessus de ma tête comme un vol de tourterelles. Quand je commence à loucher et que je croise le regard de Delphine sous ses sourcils froncés, je me redresse brusquement, suscitant l'attention de toute la tablée.
- "Oui madame Grangier ? Vous avez un avis sur la question ?", me demande le chef de service.
Je hoche la tête d'un air pénétré.
- "Je trouve que c'est une très bonne question", dis-je dans l'à bout de souffle de quelqu'un épuisé par une intense réflexion.
- « Tout à fait de votre avis. Nous en reparlerons donc lors d'une prochaine réunion. En attendant, je vous invite à vous pencher sur le point suivant, soulevé par un groupe de recherche québécois. Faites passer."
Je reçois l'équivalent d'un baobab en tas de feuilles noircies d'une frappe minuscule dont je distingue le titre. " La mise en isolement est-elle soluble dans la démocratie ?"Mais qui pond des trucs pareils ?
Je ne sais plus depuis combien de temps je suis plantée là, à regarder Jean-Pierre préparer les traitements de midi, captivée par sa lenteur marsupiale. Il examine chaque comprimé en le levant devant les yeux, comme s'il pouvait voir à travers, tout en chuchotant leur nom générique puis leur nom chimique. Il les dépose ensuite sur des coupelles vissées sur des gobelets nominatifs. Il ne semble pas du tout se formaliser du fait que je l'observe. Quand vient son tour face à l'ordinateur, Jean-Pierre perd tous ses moyens et se liquéfie. Je le croise tout l'après-midi, ratatiné sur sa chaise et le regarde disparaître un peu plus d'heure en heure. Il se trouve toujours une bonne âme, impressionnée par ce tour de prestidigitation pitoyable pour le relayer. Tristan rentre dans la salle de soins et referme la porte derrière lui en poussant un profond soupir.
- "J'en peux plus. Une heure d'entretien avec Madame R. J'ai l'impression qu'on vient de me gerber dessus."
Les délires de Madame R. sont d'une extraordinaire prodigalité en ce qui concerne les matières fécales, leur taille, leurs poids, leur consistance, leur odeur... Moi qui jusqu'alors réservais un intérêt à peine distrait pour ce travail respectueusement métabolique, j'en suis venue à me poser des questions métaphysiques sur la symbolique de la déjection et sur son expressivité. Il va sans dire que les couloirs deviennent déserts quand le médecin de madame R. s'approche d'un pas de Sioux pour coincer l'un d'entre nous et le traîner en entretien. La gêne est sans doute renforcée par le paradoxe suscité par son apparence bourgeoise et la crudité de ses propos. Le jour où elle a glissé nonchalamment au cours d'un entretien, qu'elle mangeait les selles de son mari, je n’ai pas pu réprimer un haut-le-cœur tout à fait anti-thérapeutique.
Je me demande s'il arrive au Dalaï Lama de sortir de ses gonds. J'ai du mal à l'imaginer en train de trépigner en faisant voler sa soutane ou de taper du poing sur la table en poussant un gros juron tibétain. Il a été capable de dîner avec Bush ou Sarkozy sans perdre le sourire, c'est quand même la preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Ou bien, il souriait justement parce qu'il dînait avec Bush ou Sarkozy. Tristan s'assoit, blanc et le visage de travers.
- "Docteur Morris devient meilleur de jour en jour, je l'ai même pas entendu venir cette fois. J'ai d'abord senti son odeur mais il était déjà trop tard."
Tristan est un frustré de l'armée de terre qui lui a refusé le droit de mourir bêtement sur un champ de mines anti-personnel parce qu'il était dyslexique. A toute fin, en attendant de gagner à l'EuroMillions, Tristan se console en s'imaginant faire une étude sociologique comparative entre le milieu hospitalier et la jungle. Développer ses cinq sens pour assurer sa survie, c'est sa mission. Il n'est pas rare de le voir humer l'air du couloir avec les yeux qui roulent dans leurs orbites plissées. Passé le léger malaise, la finesse des sens de Tristan s'avère très utile puisqu'il est capable de reconnaître un patient à l'odeur de son urine, qu'il repère plus vite une goutte de sang qu'un requin dans l'océan, qu'il est capable de calmer un patient agité par la simple imposition des mains et qu'il a un sonar entre les deux oreilles. De plus, depuis qu'il s'est rasé la tête, ses facultés semblent avoir gagné en acuité. Il nous a expliqué que la perte de ses follicules pileux permettait à son Chi de mieux circuler à la surface de son crâne. Grand collectionneur de westerns spaghetti et de films de Yakuza, il a percé tous les mystères de I'Ouest et de I'Est.
-"Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour cette femme, si elle veut bouffer de la merde, qu'elle la bouffe sa merde ! Pas la peine d'encombrer un lit pour ces histoires de merde, putain de merde !"
Les histoires de madame R. ébranlent même les plus aguerris d'entre nous. Son cas semble fasciner son médecin qui voit là une métaphore des plus intéressantes. Madame R. a été élevée dans une ferveur démente et sectaire de LA culture avec un grand cul et un mépris profond pour la culture de masse. Madame R. s'envoie sur un lecteur dvd compact, à l'insu de son mari, et cachée dans les toilettes, toute la série des "Feux de l'amour" et "Amour, gloire et beauté", n'assume pas un net penchant pour "C’est mon choix », glisse le magazine "Public" et "Voici " entre les pages du « Figaro » et se bâfre de nuggets sauce barbecue après avoir fait les courses chez Fauchon et Biocop. Au final, écartelée par cette dichotomie intolérable, elle se punit en bouffant de la merde au sens propre. Son médecin s'astreint depuis des années, sans résultat, à la pousser à faire son coming-out auprès de son mari et de sa famille. Peut-être a-t-elle fini par y prendre goût et manger ses déjections est devenu aussi anodin que regarder "Les Anges à Miami » ou « Touche pas à mon poste » l'est pour certains d’entre nous.
- "Qui veut aller au self ? Il y a des quenelles à midi".
C'est bas, mais j'ai envie de manger seule pour une fois. Je suis déjà habillée en civil et la main sur la porte quand Jean-Pierre s'avance vers moi dans un magnifique travelling ralenti en levant au ciel le doigt d'ET.
- "Moi, je viens. Attends je vais me changer".
J'aurais le temps d'aller jusqu'au self, de manger entrée, plat, fromage et dessert et de revenir avant qu'il ne réapparaisse mais je l'attends, merde.
Je l'aperçois de loin, en arrivant près de chez moi. Elle attend au bas de l'immeuble, adossée contre le mur, les jambes croisées, elle fume une cigarette. De loin, avec sa petite taille, elle ressemble à une jeune adolescente, ne seraient ses formes, discrètement recouvertes par un manteau en cuir marron, un jean vaguement baggy et des baskets. Elle ne m'a pas vue et je me rapproche doucement, sans faire de bruit. Elle fume, le regard perdu dans la circulation. Elle semble là plus habitée que toutes les autres fois où je l'ai vue. Je suis soudain frappée par la vulnérabilité qu'elle dégage, lovée sous ce mur gris, et mon cœur est violemment serré par un élan de tendresse. Elle tourne la tête vers moi alors que j'arrive à sa hauteur et son regard me transperce comme un pic à glace. La Reine des neiges. Mon cœur en morceaux qui s'entrechoquent avec des bruits de glaçons.
— "Salut, ça va ? » dis-je avec un sourire citronné.
Elle étire une lèvre, me regarde avec des yeux durs et opaques et jette sa cigarette d'une pichenette.
- "On monte ?"
On monte. Mon humeur s'alourdit à chaque marche. Pourquoi cette absence d'émotion me fascine-t-elle tant ? Rien à voir avec la maîtrise de soi, elle semble simplement déconnectée des parties vivantes d'elle-même. Et pourquoi j'accepte qu'elle vienne me vampiriser ?
Orgueil de la Maison qui a compris d'un clignement de prunelles qu'il avait affaire à une rivale digne de ce nom, s'éloigne en levant la queue d'une démarche chaloupée parfaitement ridicule.
- "Tu veux un thé, un café ? J'ai un blanc sucré au frigo si tu veux."
- "Non merci, je n'ai pas soif." Elle refuse avec le ton de quelqu'un qui a failli attendre.
Elle rallume une cigarette et ça me déplait. Je déteste que mon appart pue le tabac froid, odeur de mort et de décrépitude. Ça me déprime instantanément. Elle arrive à fumer en penchant la tête, le goudron sexy, pour lire sur la tranche des livres de la bibliothèque. Un mélange où les Comtesse de Ségur, Kessel et Pagnol de mon enfance côtoient des traités de psychiatrie, des livres sur les spiritualités les plus diverses et des guides de voyage.
"Je lis pas", dit-elle en s'emparant d'un livre de Sarah Waters, sans doute attirée par le titre et la jaquette. Et moi, je ne mange jamais de céréales le matin. Mais ça peut changer.
- "J'ai du mal à comprendre comment on peut rester des heures sans bouger alors que le monde s'agite tout autour."
C'est la première fois qu'elle prend la peine d'élaborer une phrase et ça me rend muette. Elle feuillette les pages en laissant tomber la cendre un peu partout.
- "Ça parle de quoi ?
- "Le parcours d'une jeune femme dans le Londres du 19ème, son premier amour passionnel, sa découverte de la sexualité et du pouvoir du sexe, avant de rencontrer un amour plus sage et plus épanoui. En gros."
- "C'est quoi un amour sage et épanoui ?", demande-t-elle avec une candeur désarmante et je suis incapable de savoir si elle se fout de moi.
- " C'est... Un amour où l'une et l’autre acceptent leur solitude fondamentale et décident d'un commun accord implicite d'y échapper de temps en temps en partageant des moments de leur vie."
Elle me regarde avec un sourire de Joconde assise sur un fer à friser. Ces gens qui vous renvoient sans un mot et sans effort vos propos en boomerang lancé à toute volée. Elle laisse lentement glisser sa main le long des rayonnages en s'avançant vers la chambre plongée dans la pénombre où j'aperçois la couette qui fait un gros tas au milieu du lit, haut comme un tipi. Elle pousse la porte et s'assoit tout au bord du matelas, les mains sous les fesses, en regardant fixement la moquette. Je me glisse le plus doucement possible à côté d'elle, peur de faire trop d'air et de la voir s'effondrer comme un château de cartes. Peur de découvrir que sous les cartes, il n'y a que le vent. Je sens qu'elle frissonne.
Je passe un bras autour de ses épaules. Penser avec des mots sans résonance pour mettre les émotions à distance, ne pas se laisser submerger, ne pas se noyer dans le flot des mots qui finiront par glisser vers l'obscurité. Chercher quelqu'un qui a des affinités avec soi, chercher à construire quelque chose de stable avec une pièce qui s'imbrique de façon satisfaisante, comme au lego, caler la table branlante, chercher à survivre à cet égoïsme qui nous étouffe lentement mais sûrement. C'est peut-être ça le mal visqueux et rampant, l'égoïsme qui nous pousse à faire des tartes aux pommes parce que c'est triste de manger seul. Et puis, on respire l'air de quelqu'un avec qui on n’a aucune affinité, qui vous fait même du mal et on s'accroche, bien qu’on n’ait pas de prédisposition particulière pour le masochisme. Elle relève la tête et regarde autour d'elle comme si elle avait perdu quelque chose.
- "Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ?"
Elle secoue les cheveux, tête baissée, et quand elle se tourne vers moi, l'incapacité à s'exprimer que je lis sur son visage m'atteint en plein cœur, avec plus de force que n'importe quelle parole. Ses yeux ont pris une teinte fondante et j'ai envie de boire l'eau qui les fait briller. Elle repousse gentiment mais fermement mon bras, l'agrippe, assure sa prise, empoigne l'autre et me plaque contre le matelas qui rebondit dans mon dos. Assise à califourchon, elle vient poser sa tête contre la mienne. Elle respire vite et fort. Je sens son souffle chaud contre mon oreille et dans mon cou. Je n'entends rien pourtant elle me parle. Je ne comprends rien pourtant je suis bouleversée. J'ai à peine le temps de me dire que c'est un peu comme pour la vie qu'elle est en moi, avec une violence qui fait perdre la tête.
- "Je ne sais pas si on va réussir à la calmer, elle est dans un sale état", dit Delphine en refermant la porte de la salle de soins derrière elle. "Ça ne sert à rien de la charger en traitement, elle n'est pas du tout réceptive aux médicaments. Je l'ai laissée avec Brigitte, de toute façon ça m'a l'air mal barré. J'appelle l'interne de garde, qu'est-ce que tu en penses ?"
Je pense que la dernière chose à faire c'est de laisser Brigitte gérer la situation mais je ne lui dis pas. Brigitte fait partie de ces infirmières psy qui regrettent sans le savoir le bon vieil asile du début du siècle, où elle pouvait balancer un trousseau de clefs lourd comme une grenade à sa ceinture avec des airs de maton, où les frontières étaient claires, "eux", "nous", et où on ne s'embarrassait pas de questions subsidiaires. Tu t'agites, je t'attache, je t'injecte. Il est vrai que la psychiatrie est en pleine névrose. Tout comme le catholicisme a discrètement balayé sous le tapis l'Inquisition et la Saint-Barthélemy, la psychiatrie ne digère pas son passé de pratiques barbares. Conditionnée par une culpabilité freudo-lacanienne paralysante, la psychiatrie cherche à se racheter et poursuit une quête éperdue de reconnaissance et de crédibilité. Cela donne lieu à des crises permanentes de réunionnite où le bien-fondé de la moindre initiative est longuement débattu, où les conséquences des changements les plus infimes sont analysées sous toutes les coutures et où tout finit par être sujet à controverse, "Doit-on mettre des couverts en plastique sur le plateau-repas d'un patient en chambre d'isolement ou ne laisse-t-on que la cuillère ? Et comment parer le risque d'énucléation ?", "Peut-on vraiment se pendre avec des lacets de chaussures ? Et le risque de strangulation ?", "Comment fait-on pour rester serein et poli en écoutant un pédophile raconter son passé avec un sourire nostalgique ?", "Quand décide-t-on d'appeler du renfort pour calmer un patient ? Est-ce que cela ne risque pas de l'angoisser et de le rendre plus agressif de voir plein de blouses blanches rappliquer ? Ou au contraire ça va le calmer sans dommage ? Et comment parer la baffe ?". L'humanité qui gère sa folie comme elle peut, partagée entre la fascination et la répulsion, l'amour et la haine d'elle-même. La grande schizophrène qui pose son propre diagnostique. Vous êtes folle madame, irrécupérable. Il s'agit maintenant d'être responsable et de vous prendre en charge, personne ne peut le faire pour vous.
Des éclats de voix nous jettent dans le couloir où mademoiselle M. s'acharne sur la porte verrouillée en poussant des cris pendant que Brigitte la regarde faire, les bras croisés, un sourire désabusé sur les lèvres. Mademoiselle M. a été accompagnée le jour même au tribunal des enfants où on lui a appris qu'elle venait de perdre la garde de sa petite fille de onze mois pour maltraitance. L'entendre raconter en entretien, avec une bonne foi totale, comment elle nourrissait sa fille avec des peaux de bananes séchées pour la faire grandir plus vite et comment elle l'hydratait avec un entonnoir pour que le fluide vital aille directement dans l'estomac sans perdre son magnétisme a été une épreuve. Incapable de se remettre en question et parfaitement ahurie par ce qui lui arrive, elle n'a rien compris au discours verbeux du juge et, terrassée par le manque, a seulement réalisé que sa fille ne se trouvait plus dans ses bras. Elle s'était endormie comme une masse au retour du tribunal, mais au réveil, sa fille ne se trouvait toujours pas dans ses bras.
- "Laissez-moi sortir, il faut que je retourne là-bas parler au monsieur !
- Il est 21h mademoiselle M., il n'y a plus personne là-bas, le tribunal est fermé.
- Ouvrez la porte, il faut que j'aille chercher ma fille, elle peut pas dormir sans moi !"
Elle s'acharne sur la poignée et sur la porte. A chaque coup, je sens l'impuissance et la résignation naissante lui donner une force de massue et ses poings commencent à bleuir. Le cœur serré, je m'approche doucement, mais elle me voit venir et me bouscule violemment pour foncer vers la fenêtre. Quand elle se met à la cogner de toutes ses forces, Brigitte s'élance :
- "Bon, ça commence à bien faire maintenant, on va se calmer ma petite dame." Elle la paralyse d'une main de fer et la traîne vers la chambre avec la nonchalance d'une femme qui revient du marché, son panier sous le bras.
- "Vous préparez l'injection les filles ?"
Oui et après on se mettra du vernis sur les doigts de pieds en se racontant nos premières fois. Brigitte me fout la trouille. Toujours peur de faire un écart de normalité en sa présence. Peur de me retrouver avec une piqûre dans le cul avant d'avoir dit fou.
En attendant, au nom de la cohésion de l'équipe, je suis la prescription médicale "en cas d'agitation" et aspire trois ampoules de Loxapac, pensée blanche, banalité du mal. Le recours à l’injection est toujours un aveu d'impuissance à aider l'autre, à le soulager de sa peine, de ses angoisses, de sa colère, de sa folie, avec des moyens plus humains que de faire glisser dans le sang des molécules chimiques jusqu'au cerveau.
Une fois mademoiselle M. emmitouflée sous les couvertures, inerte et le visage traversé de longs sillons de larmes séchées, je regarde Delphine se jeter sur la vaisselle avec ardeur. Son visage est fermé, ses lèvres pincées mais je sais qu'elle est contente que je sois là à la regarder faire. Quand elle a fini, je me sens mieux et son sourire réussit me détendre. Au moment où nous rejoignons Brigitte en train de faire les transmissions aux collègues de nuit au sujet de l'injection de mademoiselle M, je l'entends dire "non, mais il fallait qu'elle comprenne..." Qu’elle comprenne quoi Brigitte ? Que tu auras toujours le dessus ? Elle ne comprend rien à ce qui lui arrive et c'est bien ça le problème. Je me sens poisseuse en sortant du boulot, juste envie de m'enfouir moi aussi sous les couvertures et laisser les brumes du sommeil passer sur tout ça. Je trouve mon lit vaste et froid comme un parking souterrain et j'aimerais qu'elle soit là, trouver dans son corps tiède un peu de cette quiétude qui fait oublier que demain est bientôt là.
En rentrant chez moi, je trouve Anaïs, une amie de longue date, qui attend au pied de l'immeuble. Les joues fraîches et roses, elle me claque une bise retentissante dans l'oreille droite. Anaïs c'est un peu comme une boîte de Quality Street, pleine de couleurs chaudes et vives qui mettent le cœur en fête, et à l'intérieur un choix difficile à faire parce que tout est bon mais qu'il ne faut pas en abuser. Je ne sais pas où Anaïs trouve cette force intarissable qui la pousse à toujours positiver quoi qu'il arrive. Mariée à 19 ans à un homme doux et rêveur mais fragile comme une branche de sureau qui a vite rompu, cédant sous le poids d'une pneumonie foudroyante, veuve à 21 ans, orpheline à 22 d'un père disparu dans la brousse des amants de sa mère et celle-ci emportée par un cancer du sein à cinquante ans. Anaïs mène donc une vie foudroyante, dormant peu, fumant beaucoup, aimant beaucoup, sans peur et sans attente, résolue à la vie, à la mort.
- "Ca va ma belle ?", demande-t-elle de sa voix chaude et on se sent vraiment belle quand elle le dit. Je lui raconte Anna, elle me raconte Jean-Luc en sirotant le reste du blanc sucré entre deux bouffées de cigarette. - "Elle m'a pas l'air très net quand même cette fille. Je veux bien croire que parler c'est pas toujours nécessaire pour s'apprécier mais sur un long terme, tu vas vite te fatiguer. Déjà que t'es pas du genre bavard, vous allez finir par vous faire bouffer par le silence. Ça a toujours été ton grand trip ça, la symbiose dans la communication non verbale. Mais il y a peut-être une raison derrière le fait que l'être humain puisse aligner deux mots, non ?"
Je l'écoute en souriant d'un air béat, abrutie par le vin et agréablement bercée par sa voix. Une impression de bain chaud dans le noir.
- "Et ce Jean-Luc, tu vas le revoir ?
- Ohla, jamais de la vie. Tu sais qu'il a passé trois quarts d'heure à me détailler toutes les fonctions de son iPhone ? Et qu'ensuite il m'a raconté son safari au Kenya, sa rencontre bouleversante avec une vraie tribu Massaï et comment il a pleuré sur la misère de tous ces enfants qui ne pouvaient même pas avoir accès à Internet ? Ceci dit, quand il ne parle plus, il vaut effectivement le coup. T'as peut-être raison en fait..."
Elle part d'un grand éclat de rire qui me fait penser à des boules vernies sur un sapin de Noël.
- "Je peux dormir chez toi ?"
Même si elle dort peu, une des grandes particularités d'Anaïs est de s'endormir instantanément. Son sommeil est le meilleur somnifère que je connaisse. Je m'enfonce avec délice en longeant la chaîne poreuse et couverte d'algues reliée à l'ancre qui repose au fond.
Je prépare du café dans la cuisine inondée d'un soleil matinal. Une joie douce et apaisée au cœur, sans raison précise, et qui me fait murmurer quelques notes au coin des lèvres, encore pelotonnée dans le moelleux d'un sommeil profond. Renaître tous les jours, l’esprit neuf, épousseter d'un geste machinal le passé qui tente de nous enterrer. Anaïs est encore étalée sur le lit. La radio dit que le monde va mal. J'en fais quoi de cette détresse ? Je prends une corde et je me pends ? Je me jette à genoux sur le froid du carrelage ? Je fais du café, j'hésite à sortir acheter des croissants et fais griller des toasts à la place. Je les tartine généreusement de marmelade à l'orange. Un attentat a fait 36 morts et 150 blessés en Irak. Je presse consciencieusement quelques oranges, un citron et recueille la pulpe que je glisse sous ma langue. Une explosion acide dans la bouche. Une épidémie de fièvre aphteuse décime des troupeaux entiers en Grande-Bretagne. Des montagnes de vaches tordues qui monte vers le ciel noirci de cendres. Je déplie le journal du matin et m'arrête sur la météo du jour, éclaircies sur ciel gris. Un SDF retrouvé mort de froid dans une tente du bois de Vincennes, le cinquième en un mois. J'entends Anaïs s'étirer en poussant des soupirs d'aise. Avec ses cheveux hirsutes, on dirait une gamine qui fait des bruits de bouche. Elle me sourit sans un mot et mord dans un toast en hochant la tête de contentement.
Anaïs est partie en laissant ses cheveux dans la douche, le cendrier débordant, une morsure sur un toast cramé et j'aime sentir sa trace, sentir son pouls fort et puissant battre encore. Je jette un coup d'œil à mes mails avec l'habituelle sensation de démangeaison qui me parcourt le corps quand je me connecte à Internet. J’ai passé des heures face à l’écran à ses débuts, la peau moite, fébrile face à l’abondance. J’ai senti ma pensée changer, se transformer, procéder à des opérations nouvelles, va et vient entre les idées, sauts de puce et raccourcis, copié/collé mentaux, et toujours cette sensation de vide à combler, sauf que même ce vide était devenu virtuel. Et puis j’ai arrêté, d’un coup. Une sensation de fatigue immense s’abattait sur moi dès je devais allumer l’écran. J’ai écouté cette fatigue et je me force juste de temps en temps à vérifier que je ne loupe rien de capital, vu que tout se dématérialise et que je ne peux plus payer mes impôts par voie postale. Je pense souvent la nuit, quand je n’arrive pas à dormir, à tous ces tuyaux sous le sable, au fond de la mer, par où transitent toutes ces informations. Je pense aux poissons qui nagent au-dessus, au grand silence marin qui absorbe tout ce bordel et je me rendors en écoutant le bruit des bulles qui fuitent des trous percés par le temps.
Je l'appelle sur son portable. Il sonne dans le vide. Je commence à avoir du mal à respirer. Je sens la douleur poindre comme les longues pattes d'une araignée qui essaye de se cacher dans une rainure. Je n'adresse pas la parole au répondeur. J'appelle à la salle de sport, aucune envie de passer là-bas et de la voir me jouer l'acte Il, scène 3 de la parfaite soubrette commerciale. On me répond qu'Anna n'est pas là mais que Jérémaille peut s'occuper de moi. Il n'y a qu'elle qui m'aille merci. Je resonne sur son portable. Je commence à avoir mal à la tête. Deux efferalgans crépitent au fond d'un verre avec un bruit de Rice Krispies. J'avale le mélange cul sec et je pense à tous les patients à qui je tends matin, midi et soir des cocktails sirupeux en affirmant d'un ton ferme et obligeant, "Ça va vous aider à aller mieux", et j'ai toujours le vertige quand je dis ça.
J'appelle une dernière fois sur son portable avant de partir travailler et là j'entends clairement qu'on coupe la sonnerie. Je ne dis même pas bonjour à la concierge qui s'en arrose les mules. Je croise sur ma route des corbeaux bedonnants, des pigeons amputés et le vent souffle dans les branches d'arbres aux troncs encerclés dans le fer. Le trottoir se gondole sous la force des racines puissantes qui finiront par faire péter tout ce béton.
- " Elle a avalé une couronne", me dit Jean-Pierre en hochant lentement la tête d'un air appréciateur.
- "Hein ?
- Elle a perdu une dent quoi, et elle l’a fait passer avec une gorgée de café.
- Mais ça peut lui perforer l'estomac !
- On a vu avec le stomato, elle a reçu une bonne dose d'huile de Paraffine pour tapisser l'estomac et deux litres de Colopeg pour évacuer tout ça.
- OK et c'est quoi le protocole à suivre, on attend en lui tenant la main sur le pot ?
- En gros, c'est ça oui. On doit faire "une surveillance et une étude des matières organiques". Recueillir la merde et fouiller dedans pour trouver la dent quoi."
Le seul avantage à être infirmière, c'est que les gens sont prêts à vous aimer d'emblée, sans préjugé. Comme les pompiers. C'est beau, c'est rare. Et une sacrée responsabilité. Être à la hauteur de cette confiance qu'on vous donne spontanément
Madame S., me sourit avec sa case en moins sous la gencive. Elle ressemble à un gracieux cachalot, échouée sur son lit comme si elle ne pouvait plus jamais en sortir, blonde et le visage comme de la pâte à modeler. Elle a un long passé d'escort-girl et de nombreuses interventions de chirurgie esthétique derrière elle.
- "Bonjour Madame S. Comment vous vous sentez ? J'ai appris pour votre dent, ne vous inquiétez pas, on va surveiller ça", dis-je en retapant les bouts d'oreiller que je peux atteindre dans son dos.
- "Bonjooouuuur mon petit marshmallow, tu vas bien ? Mais tu as une petite mine dis donc. Regarde-moi un peu, tu as pleuré non ?"
Madame S., qui considère l'hôpital comme sa résidence secondaire vu qu'elle y passe les deux tiers de l'année, est la diva de notre service, exubérante et maternelle, le genre de mère qui vous fout la honte dès qu'elle ouvre la bouche mais qui fait fondre tous vos problèmes contre sa poitrine moelleuse. Elle est dotée d'une sensibilité exacerbée qui lui fait voir les mouvements de l'âme des uns et des autres traverser la pièce aussi distinctement qu'un feu d'artifice, mais de façon tout aussi éphémère. Esclave de son hypersensibilité et d'un gros trouble bipolaire, elle est soumise à une fluctuation de l'humeur aussi sinusoïdale qu'un oscilloscope qui s'emballe. Dans les bons jours, à la bonne heure, à la bonne minute, je suis son "petit marshmallow", son "sucre d'orge" ou Fanny Ardant. Mais qu'un courant d'air la refroidisse et je deviens le Sheitan.
Nous n'avons jamais récupéré sa dent qui doit flotter quelque part dans une bouche d'égout parisienne.
Toujours pas de nouvelles quand je rallume mon portable. L'araignée s'est dépliée au centre de la toile, immobile et sur le qui-vive. J'attends d'être arrivée chez moi pour l'appeler à nouveau. Elle décroche enfin et son "Allô" excédé finit de m'achever.
- "Désolée, tu avais dit que tu passerais ce soir, j'ai dû mal comprendre. » J’hésite à raccrocher, là tout de suite.
- « Oui, mais je ne peux pas ce soir, j'ai des choses à faire et des gens à voir."
Des choses à faire et des gens à voir.
- "Anna, je ne comprends pas, tu veux quoi au juste ? C'est juste un plan cul que tu veux, c'est bien ça ? Ça me gêne pas mais je veux juste que les choses soient claires, c'est tout".
Elle ne répond pas et laisse le silence s'épaissir. Je sais que ce n'est pas de dire crûment son désir qui la gêne. Il y a autre chose que je ne devine pas.
- "Bon, il faut vraiment que je te laisse...
- Oui, je sais, des choses à faire, des gens à voir." Et une vie à vivre, sans moi.
- "Écoute, je sais que j'avais dit que je viendrais et c'est pas que j'ai pas envie de te voir mais c'est juste que c'est difficile pour moi en fait.
- Qu'est-ce qui est difficile ? Je ne comprends pas.
- Ton regard, tes attentes...
- Tu trouves que je te mets la pression ?", je demande étonnée, c'est bien la première fois que je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression d'abuser du besoin de voir l'autre.
- "Non c'est pas ça... " Je l'entends soupirer, s'agiter où qu'elle soit assise. Elle porte du nylon.
" C'est juste que j'ai l'impression que tu cherches à m'analyser, que tu me regardes en te posant trop de questions. Bon écoute je dois partir là, on s'appelle un de ces quatre ? Ciao."
Ciao. Alors c'est ça son problème ? Elle ne supporte pas que quelqu'un puisse la regarder et la voir telle qu'elle est ? Je reste figée devant le mur blanc. Sa bouche. Je laisse mes épaules s'affaisser. Sa peau. Peur que je me pose trop de questions à son sujet ? Elle s'est sentie agressée par mon intérêt pour elle ? Sa langue. Elle préfère continuer à longer la falaise, sans s'approcher du précipice, trop peur de tomber et d'en mourir. Mourir à soi-même. Sauter, plonger, quitte à se noyer, il y a toujours des berges providentielles, des branchies peuvent se développer et le talon, pousser le fond.
Deux jours de repos devant moi et aucune envie de distraire ma douleur le long des quais de la Seine ou au milieu d'une soirée avec des amis où j'aurais l'impression d'être une statue du Musée Grévin. Aucune envie de parler en fait, rien à en dire, prise dans un torrent boueux qui m'emporte au milieu d'un tas de branches et de cailloux. Rien que de très banal au fond, mais le banal ne fait-il pas plus mal que l'extraordinaire ? La perspective de tourner en rond dans mon deux-pièces me parait tout aussi réjouissante que d'écouter une œuvre entière de Wagner avec une solide gueule de bois. Je décide de m'exiler en province, dans la maison de mes parents. Besoin d'espace, besoin d'oxygène, besoin de faire exploser ma cage thoracique.
J'ai l'impression d'avoir de la rouille plein les articulations. Un mal fou à aller jusqu'à la gare et à trouver le quai.
Je me détends un peu, assise sur un banc froid comme du fer battu au courant d'air. J'aime bien les gares, la perte de repères et le sentiment de dépersonnalisation. L'espace-temps flou, le corps ici, l'esprit déjà là-bas et entre les deux, ce temps suspendu où l'on sait ce qu'on quitte sans être sûr de ce qu'on va trouver. Embarquée dans une machine puissante sans pouvoir sauter en marche, on ne sait pas trop comment se passera le voyage, peur de s'ennuyer, de n’avoir pour seul distraction que le paysage qui défile, mais on n’est pas toujours sûr de vouloir arriver.
La maison est silencieuse quand j'arrive, mes parents partis pour le week-end. J'enfile un vieux pyjama élimé. Ça me fait monter les larmes aux yeux. Pouvoir régresser tendrement, dans une illusion de sécurité mais pouvoir régresser quand même, oublier que la vie fait mal. Bref passons. Parce que tout passe. Je n'ai pas quitté mon vieux pyjama de tout le week-end et j'ai dormi et dormi, abîmée dans un sommeil profond et sans rêve. Quand j'ai le malheur de me réveiller, c'est le goût de sa peau que j'ai sur la langue et son nom qui résonne à mon oreille. Alors je me rendors, tendrement veillée par les chats de la maison, deux adorables créatures rendues un peu stupides par l’émasculation. Et pendant tout ce temps où je m'apitoie sur moi-même, une voix intérieure, si fluette et ténue me répète encore et encore, un travail d'hypnose souterrain, "Tu la connais à peine, tu t'en remettras va, une fois la fièvre passée, tu t'en remettras", quelque chose dans ce goût-là. Ce n'est pas une voix piégée par les travers du langage. Elle glisse, elle s'immisce, elle s'enroule et pose une main fraîche sur mon front brûlant.
Je finis par émerger le dimanche en début d'après-midi. En quittant le pyjama moite de chaleur, en prenant une douche, en réveillant mes sens ensommeillés et endoloris sous le jet d'eau tiède et la peau rugueuse du gant de toilette, en faisant mousser le savon et en imprégnant de shampooing mes cheveux, je sens un peu de bien-être revenir, un peu de paix soulager les dernières heures.
Le ciel est lourd et gris, épais comme du métal. Envie de sentir l'air frais sur mon visage et le vent souffler sous mon crâne. J'enfile des bottes crottées, un vieux K-way rose fluo. Je marche les yeux baissés, un poids sur la nuque. La terre craquelle. Des pics durs de boue givrée que j'écrase, des flaques vitreuses où s'est figé le vert de l'herbe. Un vent vif me pousse dans le dos et me fait relever la tête. La forêt est à l'heure la plus poignante de l'hiver. Des squelettes noueux où frétillent quelques feuilles, des nids vides et dépenaillés, une odeur de vide.
Je marche depuis deux heures et mon sang qui s'échauffe me donne envie de bouger, de sauter, de courir. Je cours. Je m'arrête hors d'haleine, les poumons râpeux et m'assieds au pied d'un tas de troncs saucissonnés comme des bûches. Je pose la tête contre le bois et frotte ma joue contre l'écorce rugueuse en fermant les yeux jusqu'à me faire mal. Un pic-vert frappe son bec quelque part entre les branches. Tout est calme, immobile et silencieux.
Le froid finit par me gagner. En me relevant, je sens une vive brûlure au creux de mon poignet et j’y vois apparaître une constellation de petits boutons rouges et irrités. Merde, qu'est-ce que ça pique. A mes pieds, contre un tronc pourri, un fouillis de plantes où percent des gerbes d'orties. C'est la première fois que je me fais avoir par surprise par une ortie. Je les ai toujours manipulées sans crainte, inoffensives quand on les caresse dans le sens du poil. Ces poils urticants tellement fragiles qu'ils se cassent comme des ampoules de verre quand on les touche et qui injectent directement leur venin sous la peau. J’ai lu quelque part que la salive est le meilleur remède pour soulager de la sensation de brûlure. Je regarde mon poignet enflammé et j'y pose doucement les lèvres puis la langue. Je salive sur ma peau un long baiser.
Mon cœur bondit quand l'interphone sonne.
- "C'est moi, Elizabeth", avec un sourire dans la voix.
C'est elle.
- "Je descends tout de suite."
Je vérifie que je n'ai rien oublié, je passe la main le long du chat et je redresse dans son vase, un bouquet d'orties, dont le duvet soyeux brille à la lune.
Tanerore